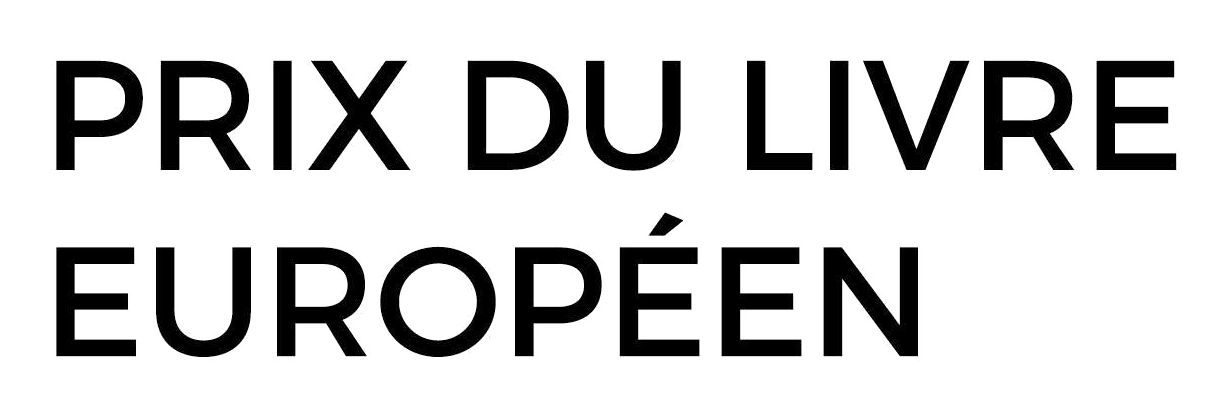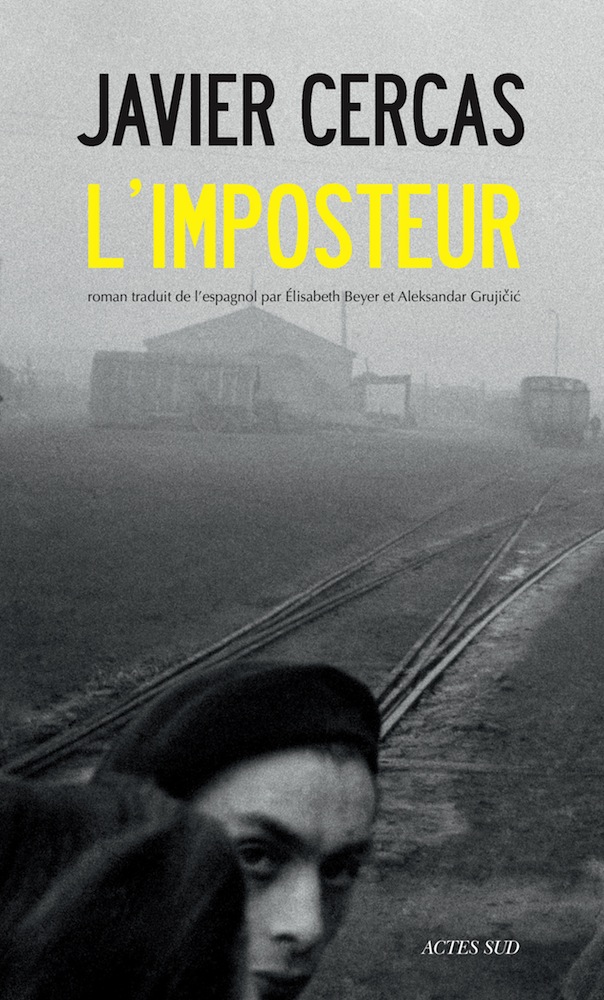Discours de l’auteur à l’occasion de la remise du Prix du livre européen 2016
En premier lieu, je tiens à remercier du fond du cœur le jury qui m’a accordé ce prix. Ensuite, je veux dire que ce prix compte beaucoup pour moi, parce qu’il est accordé par le Parlement Européen.
Pendant des siècles, l’Europe a été la grande illusion de beaucoup d’Espagnols ; conscients de vivre depuis le début du XVIIe siècle dans un pays de plus en plus isolé, de plus en plus enfoncé dans la pauvreté, l’inculture, l’absence de libertés, l’obscurantisme et la fiction de l’Empire, depuis le milieu du XVIIIe siècle les meilleurs de mes ancêtres ont senti que l’Europe était une promesse réaliste de modernité, de prospérité et de liberté. Aujourd’hui, la grande majorité d’entre nous le sentent encore, c’est pourquoi l’Espagne n’a cessé d’être un des pays les plus européistes de l’Union. Je crains qu’en ce moment-même nous manquions de raisons de nous sentir fiers d’être espagnols, mais celle-ci en est une. J’ai déjà écrit que l’idée d’une Europe unie est la seule utopie raisonnable que les Européens aient forgée ; nous avons forgé plusiers utopies atroces – des paradis théoriques transformés en enfers bien concrets –, mais à ma connaissance une seule est raisonnable, celle-ci : une utopie qui, comme vient de le rappeler Michel Serres, a permis qu’après la Seconde Guerre mondiale les Européens connaissent « l’époque de paix et de prospérité la plus longue depuis la Guerre de Troie ». Cela dit, j’ajouterai que le roman moderne n’est pas seulement un des plus beaux fruits de cette utopie, mais aussi celui qui lui ressemble le plus, son emblème parfait ; la preuve en est que ses deux traits les plus remarquables appartiennent aussi à l’Europe unie : son caractère hybride, métis, et sa nature antidogmatique.
Le roman moderne est l’invention absolument géniale d’un Espagnol, Miguel de Cervantes, pourtant ce ne sont pas les Espagnols, mais certains Anglais, comme Lawrence Sterne ou Henry Fielding, qui ont les premiers appris à fond les enseignements de Cervantes et en ont assuré la continuité; par ailleurs, ce ne sont ni les Espagnols ni les Anglais, mais un Français, Gustave Flaubert, qui a assumé la tâche immense d’élever au rang d’art noble ce qui jusqu’alors avait été pour presque tout le monde un simple divertissement : et c’est un fait que personne n’a mieux assimilé Flaubert que James Joyce, un Irlandais qui écrivait en anglais et qui a presque toujours vécu en exil sur le continent, ou qu’un Tchèque qui écrivait en allemand et s’appelait Franz Kafka, de même que c’est un fait que peu d’écrivains actuels ont été aussi fidèles au legs de Kafka et de Joyce que Milan Kundera, un Tchèque qui a commencé à écrire en tchèque et a fini par écrire en français. Le roman moderne est un genre métissé, non seulement parce que Cervantes l’avait ainsi créé – un genre contenant tous les genres et se nourrissant d’eux tous –, mais parce que son histoire est l’histoire d’un métissage profond de langues et de cultures. Cependant, le roman moderne est aussi un genre antidogmatique. Parce que ses vérités ne sont ni claires, ni univoques, ni tranchées, mais au contraire ambiguës et équivoques, essentiellement ironiques. Sans aucun doute, don Quichotte est fou, fou à lier, il a perdu la boussole, mais en même temps c’est l’homme le plus lucide et le plus sensé du monde ; sans aucun doute, don Quichotte est un personnage risible, comique, grotesque, mais en même temps c’est un personnage noble et héroïque, « le roi des hidalgos, le seigneur des tristes » qu’a chanté un grand poète nicaraguayen, Rubén Darío. Telles sont les vérités du roman : des vérités contradictoires, plurielles, polyfacétiques et paradoxales, essentiellement ironiques. Et en inventant un genre qui connaît un succès retentissant fondé sur cette sorte de vérités, Cervantes a créé une authentique arme de destruction massive contre la vision dogmatique, moniste, fermée et totalitaire de la réalité.
C’est contre cette vision qu’est née l’Europe moderne, l’Europe de la raison, de la liberté, du bien-être et du progrès ; c’est contre cette vision – et contre les totalitarismes et les nationalismes purs et durs ou opposés au métissage qui ont plongé le XXe siècle dans un bain de sang – qu’est née l’Europe unie. Cette vision, autant ne pas nous leurrer, menace de revenir maintenant, ou elle revient déjà, comme si nous voulions donner raison à Bernard Shaw, qui écrivait : « La seule chose que nous apprend l’expérience, c’est que l’expérience ne nous apprend rien ». Car, contrairement à ce que nous avons coutume de penser, l’histoire se répète toujours, mais sous des formes si différentes qu’il est parfois difficile de la reconnaître. Aujourd’hui ce n’est pas même difficile : aujourd’hui, après que les Britanniques ont commis la folie de s’isoler de l’Europe, comme s’ils étaient des Espagnols du XVIIe siècle, et après que les Américains ont confié le pouvoir à un sinistre démagogue, c’est presque devenu un cliché de comparer notre époque à celle des années trente, au point que certains historiens se sont cru obligés de rappeler les différences entre ces deux époques. Je trouve ça bien. Mais je trouve moins bien – en fait je le trouve téméraire– d’oublier les similitudes entre cette époque terrible et la nôtre : une grave crise économique, le profond discrédit des élites et des institutions démocratiques et la rébellion antisystème généralisée, le retour du nationalisme et du totalitarisme sous la forme plus ou moins policée du populisme de droite et de gauche, le remplacement d’une politique rationnelle et pragmatique par une politique épique et sentimentale, le recours politicien au mensonge en doses massives. On pourrait même aller plus loin. On pourrait en effet se demander si, après soixante ans de paix et de prospérité, l’Occident – et pas seulement l’Europe – n’incube pas une sorte de grand ennui semblable à celui qui, comme le rappelle George Steiner, s’incubait après les cent ans de paix et de prospérité relatives qui succédèrent aux guerres napoléoniennes, un état d’âme qui produisit une soif d’intensité collective et un désir secret de destruction et de mort, tellement visible dans l’art de cette époque-là (« La barbarie plutôt que l’ennui ! », s’était exclamé Théophile Gautier), et qui devint le carburant idéal pour les deux guerres mondiales qui détruisirent l’Europe alors que tant de gens pensaient qu’une nouvelle guerre en Europe était devenue presque impossible… Mais j’exagère peut-être. Peut-être je me laisse emporter par le pessimisme : en définitive, il est encore temps de faire mentir Bernard Shaw et d’écouter Cervantes, qui a écrit que l’histoire doit être « modèle et leçon pour le présent, et avertissement pour l’avenir ». En tout cas, une chose me semble certaine, c’est que, dans cette époque sombre, l’Union européenne non seulement continue d’être le projet politique le plus ambitieux du XXIe siècle, notre seule utopie raisonnable, mais tout simplement le grand espoir de la démocratie dans le monde. Il est vrai que, telle qu’elle fonctionne actuellement, l’Union européenne ne peut satisfaire personne, que ses défauts et ses insuffisances sont énormes et ses problèmes colossaux, mais cela signifie simplement qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous, les romanciers européens, nous devons faire le nôtre, qui consiste à suivre l’exemple de Cervantes ; mais vous, le personnel politique de l’Europe, vous devez aussi faire le vôtre, qui tout bien pesé est à peu près le même : construire une Europe plus cervantine, c’est-à-dire plus antidogmatique et plus métissée, c’est-à-dire plus libre, plus prospère, plus forte et plus unie. Au nom de l’intérêt de tous, je vous souhaite bonne chance.
Merci beaucoup.